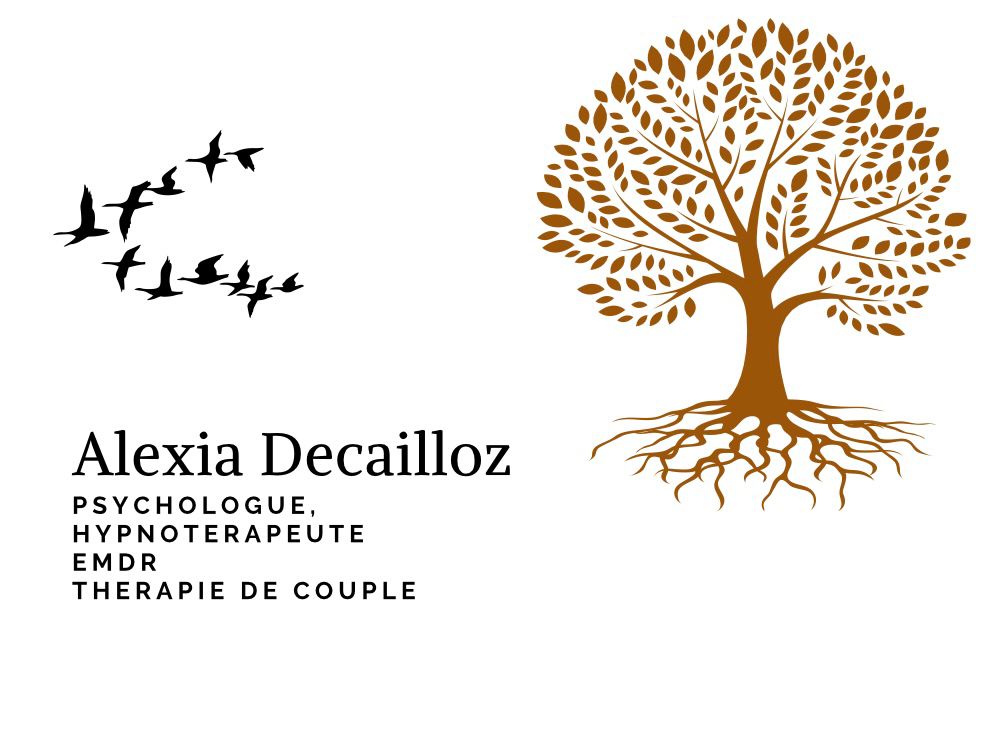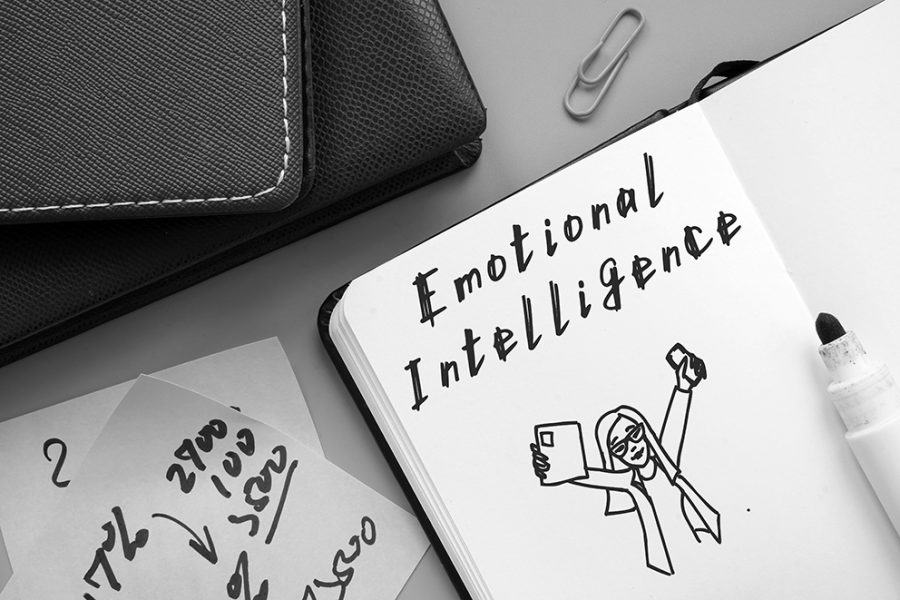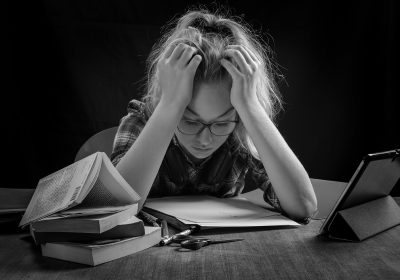Depuis plusieurs années, ce concept connait un succès grandissant. Son intérêt s’est révélé en 1995 notamment au travers du succès du best seller du journaliste scientifique Daniel Goleman avec « Emotional intelligence ».
L’idée selon laquelle le QI (qui mesure l’intelligence analytique), est le facteur principal de réussite sociale, professionnelle et sentimentale, fut alors remise en cause. L’intelligence émotionnelle est alors apparue comme un recours face à la fatalité d’un QI inné.
L’intelligence émotionnelle (QE) a attiré de nombreuses critiques, mais elle représente toutes les qualités qui ne peuvent être mesurées par un test de QI : motivation, confiance, optimisme,…
Nous la définirons comme un ensemble spécifique de capacités, liées à la reconnaissance et à la gestion des émotions.
Pour les stoïciens, les émotions étaient trop ardentes et imprévisibles pour être utiles à la pensée rationnelle. Cependant, de récentes études (A Damasio et al. Université Souhern California) ont démontré qu’émotion et raison sont inséparables.: en l’absence d’émotion, les décisions prises peuvent ne pas être bonnes et inversement, ceux qui se laissent guider par leurs émotions, prennent sans le savoir des décisions efficaces.
Ce sont Peter Salovey et John Mayer, qui ont officiellement introduit le terme d’intelligence émotionnelle en 1990, en la définissant comme la capacité à surveiller ses propres sentiments et ceux des autres, à les discriminer et à utiliser cette information pour guider sa réflexion et ses actions.
Nous pouvons donc comprendre l’intelligence émotionnelle comme un modèle qui compte 4 domaines de compétence liés:
– La capacité à percevoir les émotions
– La capacité à utiliser les émotions pour faciliter le raisonnement
– La capacité à comprendre le langage des émotions
– La capacité à gérer les émotions, aussi bien les siennes que celles des autres.
Ces capacités varient d’un individu à l’autre et ont d’importantes conséquences sociales. Seth Pollak a ainsi montré que la maltraitance peut perturber la capacité des enfants à percevoir les expressions faciales.
D’autres chercheurs ont aussi démontré que certaines humeurs (joie), peuvent favoriser la réalisation de certaines tâches (la création). Ou encore que la capacité à distinguer précisemment ses émotions aide à les gérer plus efficacement (Lisa Barrett, Boston).
L’intelligence émotionnelle permet ainsi d’établir et de maintenir de bonnes relations avec ses pairs ; de mieux gérer ses relations amoureuses.
Bien que la recherche ait avancé, plusieurs pistes restent à explorer : Pourquoi certains sont ils plus enclins à tirer perti de leur intelligence émotionnelle ? Pourquoi certains manient ils mieux leurs émotions que d’autres ? Comment se manifestent les différences individuelles dans les processus émotionnels ? …
Intelligence émotionnelle et neurosciences
Faites confiance à vos émotions, disent les neurosciences
Dans certains cas, non, ne pensez pas avec votre tête. Si ce n’était pas si niais, on dirait, «pensez avec votre coeur». A défaut: avec vos émotions. C’est ce que suggèrent les résultats d’études récentes, révélant que les décisions prises grâce aux émotions et non de manière rationnelle, sont souvent des décisions plus pertinentes.
La dernière étude qui en atteste, rapporte Wired, est celle réalisée par Michael Pham, de l’université de Columbia.En demandant à des étudiants de premier cycle de faire des prédictions sur différents sujets (des résultats de concours télévisés, sportifs, de primaires politiques, même de météo!), le chercheur s’est aperçu que de manière systématique, les prédictions étaient plus pertinentes lorsqu’elles avaient été faites en fonction des sentiments, des émotions.
Il a appelé ce phénomène «l’effet d’oracle émotionnel».
Wired précise:
«Ces dernières années il est devenu évident que le cerveau inconscient est capable de traiter des quantités importantes d’informations en parallèle, permettant ainsi une analyse de données très large sans être dépassé.»
Alors que la raison, elle, a une capacité d’analyse d’informations beaucoup plus restreinte en un seul temps donné.
Pour que les résultats soient probants, il faut que le sujet ait une connaissance minimum du thème sur lequel il fait des prédictions, précise un article du Wall Street Journal sur l’étude. Car si le cerveau inconscient est plus rapide et plus apte à mettre en lien des informations que le cerveau conscient, reste qu’il a besoin de disposer de ces informations.
La rapidité du cerveau inconscient est une question sur laquelle les neurosciences se penchent depuis quelques années, et ses qualités sont une évidence. «Lorsqu’on freine devant un obstacle en voiture, heureusement qu’il ne s’agit pas d’une action consciente. Le temps de prendre la décision consciemment, et on l’aurait heurté!», précisait ainsi Marc Jeannerod, directeur de l’Institut des sciences cognitives, interrogé dans un article du Journal du CNRS.
L’article du CNRS poursuivait:
«Etre conscient, cela prend du temps ! Du coup, l’inconscient revêt une importance dans nos comportements que l’on ne soupçonnait pas. Bien plus qu’un simple appui à la conscience, il aurait une part prépondérante dans tous les processus cognitifs: 90 % de nos opérations mentales seraient inconscientes !»
Le côté obscur de l’intelligence émotionnelle
Par Jean-Laurent Cassely |
Introduit au début des années 1990, le concept d’intelligence émotionnelle, qui reconnaît l’importance de la détection, de l’expression, de la compréhension et de la gestion des émotions, a été considéré depuis comme la solution à un large éventail de problèmes sociaux, rappelle le professeur de management et de psychologie Adam Grant sur The Atlantic.
L’idée sous-jacente est que si les émotions sont prises en compte à l’école ou au sein de l’entreprise, le monde deviendra plus coopératif et attentif à l’humain… Mais «grâce à des méthodes de recherche plus rigoureuses, poursuit l’auteur, on assiste à une reconnaissance croissante du fait que l’intelligence émotionnelle —comme toute compétence— peut-être utilisée pour le bien ou pour le mal».
Un «usage stratégique de l’intelligence émotionnelle dans les organisations» peut ainsi en faire une arme redoutable au service de comportements mal intentionnés. D’une part, maîtriser ses émotions permet de masquer ses véritables intentions, et savoir reconnaître les émotions des autres peut aider à les manipuler dans un sens contraire à leurs intérêts.
Une étude menée en 2011 par Stéphane Côté de l’université de Toronto, intitulée «Le Jekyll et Hyde de l’intelligence émotionnelle», montre par exemple que les employés les plus machiavéliques dans leurs relations de travail sont aussi ceux qui disposent d’un haut niveau d’intelligence émotionnelle.
Professeur à Cambridge, Jochen Menges écrit dans une étude que «quand un leader faisait un discours inspirant rempli d’émotion, l’audience était moins à même de s’attacher au message et se rappelait moins de son contenu. Ironiquement, les membres de l’audience étaient si émus par le discours qu’ils affirmaient s’en rappeler mieux». C’est ce que le chercheur nomme «l’effet de sidération». Cette capacité d’un leader à suspendre le jugement critique des auditeurs au profit de l’émotion pure était d’ailleurs parfaitement connue d’Adolf Hitler.
L’objectif d’Adam Grant est de montrer qu’il faut cesser l’association systématique entre intelligence émotionnelle et qualités morales.
Qu’elle soit associée ou non à des valeurs positives, l’intelligence émotionnelle est en tout cas perçue comme une compétence de plus en plus centrale dans la vie professionnelle. Daniel Goleman, à l’origine de l’ouvrage qui a fait connaître l’intelligence émotionnelle au grand public en 1995, a popularisé l’idée selon laquelle elle comptait plus que le quotient intellectuel dans la réussite sociale et professionnelle.
Dans un article récent du Financial Post, Ray Williams affirme que l’intelligence émotionnelle prédit désormais la réussite professionnelle mieux que d’autres facteurs comme les compétences techniques, l’éducation ou l’origine sociale:
«Les compétences émotionnelles, ou la capacité à construire et entretenir des relations positives, sont en train de remplacer les compétences traditionnelles ou cognitives comme manière de prédire le succès potentiel et continu d’une carrière».
Mais là encore l’article de The Atlantic remet en cause cette idée. Pour un certain nombre de métiers qui réclament moins de compétence émotionnelle, la maîtrise de l’intelligence émotionnelle deviendrait un handicap plutôt qu’un atout. Dans ces postes, les employés les plus intelligents émotionnellement sont aussi les moins performants, affirme l’auteur.
«Si votre job consiste à analyser des données ou à réparer des voitures, il peut être assez gênant de lire les expressions faciales, les tonalités de la voix et les langages corporels des gens qui vous entourent. Suggérer que l’intelligence émotionnelle est critique sur le lieu du travail revient peut-être à placer la charrue avant les bœufs».